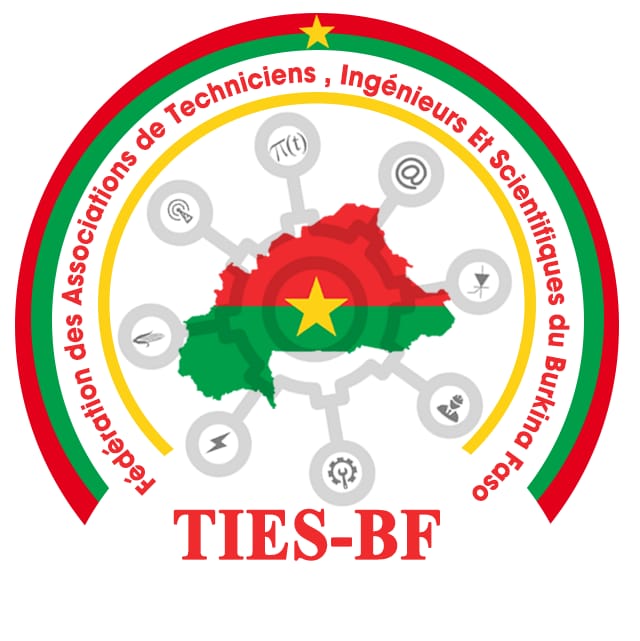QUELLE DIFFERENCE ENTRE LE ROLE DE CHERCHEUR ET CELUI D’INGENIEUR ?
On m’a souvent demandé quelle différence il y a entre le métier d’ingénieur et celui de chercheur. Cette question a son importance parce que les activités menées par ces deux sont de natures assez différentes et qu’elles demandent des modes de gestion et de pilotage différents, modes de gestion qui peuvent aller jusqu’à l’externalisation. Pour des dirigeants qui n’ont pas à l’origine un profil ingénieur ou chercheur la distinction peut être difficile à faire.
Ce post reprend les deux exemples avec lesquels j’illustre souvent cette différence. Il complète celui sur la relation entre production et R&D. En d’autres termes il décompose le terme R&D en ses deux parties R et D. L’utilisation fréquente de ce terme comme une boîte noire montre que la distinction entre les deux n’est ni simple ni intuitive.
Un portique pour turbine hydrolienne
Deux chercheurs veulent installer une turbine hydrolienne dans un canal pour faire des tests. Ils doivent concevoir un portique pour tenir ces turbines en place face au courant. Ils estimaient à pas moins de trois le nombre de thèses nécessaires pour y parvenir : une pour comprendre les vibrations dans la structure, une pour comprendre le comportement du flux d’eau perturbé par la turbine et une pour comprendre comment tout cela influait sur les efforts mécaniques que la structure porteuse devra supporter… Au minimum quatre à six ans de délai avant de pouvoir mettre une machine à l’eau si cette démarche avait été suivie…
Cette histoire fait souvent sourire. Parce qu’elle met en évidence le décalage entre les moyens imaginés comme nécessaires et le problème à résoudre. Pour installer un tel portique, un peu d’ingénierie suffit, nul besoin de recherche.
La question qui se pose souvent est que puisque l’objet qu’on veut concevoir est nouveau, est-ce que cela n’implique pas que de la recherche soit nécessaire pour le concevoir ? En fait ce n’est pas un bon critère d’analyse.
Quelques critères qui caractérisent une activité d’ingénierie
- Dans cet exemple de portique, il suffit de le concevoir suffisamment résistant pour qu’il encaisse les efforts que le courant et les hydroliennes vont exercer dessus. Pour cela il suffit de mettre en œuvre des règles de dimensionnement et de calcul établies par l’état de l’art. Le travail de l’ingénieur consiste à s’assurer que l’objet, l’ouvrage ou le procédé qu’il conçoit remplit les fonctions qu’il est supposé produire, dans le respect de certaines contraintes (de prix, de volume, de poids, …), le tout en garantissant le respect l’ensemble des lois, règlements, codes et normes en vigueur.
- La créativité de l’ingénieur va s’exprimer dans l’usage qu’il fait des règles, et dans les combinaisons inattendues ou originales de techniques qu’il fait. Sa performance sera mesurée par sa maîtrise des coûts et des délais.
- Bien que les cas d’applications de l’état de l’art puissent être nouveaux, ici par exemple le portique qui doit tenir une hydrolienne, il n’en reste pas moins que les règles applicables sont connues. L’ingénieur peut faire face à des situations complexes : l’application de deux critères de conception conduit souvent à trouver un optimum entre les deux, et peut parfois conduire à des contradictions. Le talent de l’ingénieur sera de trouver des solutions élégantes qui concilieront l’ensemble des contraintes : par l’usage original dans le domaine d’un matériau connu dans d’autres applications, par le recours à une solution restant dans le domaine connu mais néanmoins créative.
- Dans l’exemple du portique, bien que ce cas particulier soit nouveau, poser une structure qui va subir des contraintes fait appel à des règles de l’art connues, quitte à devoir prendre quelques marges de sécurité en plus par rapport à des cas connus.
Des critères d’évaluation de comportements des sols
En cas de séisme, des sols sur lesquels reposent des constructions peuvent se liquéfier, c’est à dire perdre d’un seul coup leur solidité. Prévoir la résistance à la liquéfaction des sols et donc un enjeu important pour un(e) ingénieur(e) géotechnique.
L’approche la plus ancienne et toujours la plus utilisée pour cette prévision est une procédure établie par Seed & Idriss (1971) et calée sur des données de séismes propres aux USA. Cette méthode a l’avantage d’être relativement simple à mettre en œuvre et de garantir des marges de sécurité importantes. Mais elle présente l’inconvénient de ne pas tenir compte de la réalité des séismes de la localisation exacte où l’on veut faire une construction, et d’induire des surcoûts dans les projets : une méthode plus précise et prenant en compte les spécificités du site permettrait de dimensionner des structures plus légères.
Depuis quelques années, une approche alternative de l’évaluation de la résistance à la liquéfaction d’un sol donné a été développée. Elle l’a été à partir des cas réels, d’essais de laboratoires et de simulations. Cette méthode nouvelle est fondée sur une compréhension fine des phénomènes à l’œuvre lors d’un séisme, ce qui permet de bien maîtriser ses conditions de validité et de prendre en compte les paramètres de séismes propres à chaque localisation.
Au final, elle permet l’évaluation du potentiel de liquéfaction des sols sur un large éventail de tremblements de terre.
Le côté très concret et opératoire de la détermination du potentiel de liquéfaction d’un sol pourrait faire penser qu’on est là dans un travail d’ingénierie. Là encore, ce n’est pas le bon critère.
La Recherche & Développement
- Pour réduire les marges de sécurité face au séisme, il ne suffit pas d’appliquer l’état de l’art existant. Il faut pour cela enrichir l’état de l’art, et enrichir l’ensemble des solutions disponibles aux ingénieurs.
- Une façon de voir la recherche est de voir les chercheurs comme des personnes qui apprennent à faire de nouvelles choses, ou à faire certaines choses autrement. Elles sont en permanence à explorer l’état de l’art actuel, à identifier des pistes d’amélioration et à les explorer.
- La différence majeure avec l’ingénierie est que dans ce travail de création d’état de l’art, il n’y a pas de codes et normes pour dicter quoi faire. La démarche scientifique guide le chercheur sur « comment faire ». Elles lui donnent quelques règles à suivre pour que ses résultats soient convaincants pour la communauté de spécialistes qui vont progressivement valider le nouvel état de l’art.
- Il va falloir en effet qu’à l’issue de ses travaux, le chercheur partage avec la communauté de chercheurs de son domaine, et avec les ingénieurs intéressés par ses résultats, le nouvel état de l’art qu’il a créé. Il va falloir que ces partenaires aient un degré de confiance suffisant dans ses résultats pour accepter de les utiliser. C’est toute la dimension pédagogique du métier de chercheur qui va de la publication d’articles au cours magistral.
- La liberté du chercheur réside dans le choix du nouvel état de l’art qu’il vise d’apporter. La valeur et la pertinence de ses travaux sera déterminée par l’importance du progrès que ce qu’il va créer va permettre par rapport à l’état de l’art actuel.
- Le chercheur utilise des méthodes de travail qui vont lui permettre d’explorer des idées: Bibliographie, recherche amont, modélisation, essais, observations, …
- Il utilise aussi des moyens pour valider sa méthode, démontrer sa validité, et si l’enjeu est important cette démonstration se fait souvent avec des tiers (organismes normatifs, organismes accrédités, …) qui vont contrôler, vérifier les résultats, refaire les essais …
Pour le décideur ou le dirigeant, la question à se poser pour déterminer quel type de travail (ingénierie ou chercheur) sera requis : Ce qui doit être développé comme innovation nécessite-t-il de faire évoluer les règles à suivre ?
En complément des critères rapidement brossés ci-dessus, les définitions de l’ingénierie et de la recherche données dans “Les processus d’innovation, conception innovante et croissance des entreprises“ par Pascal Le Masson, Benoît Weil et Armand Hatchuel (pages 211 et 217) sont très utiles pour répondre à cette question :
- La recherche : processus contrôlé de production de connaissances. L’idée centrale est celle de “contrôle“.
- L’ingénierie (appelée aussi développement) : processus contrôlé qui active des compétences et des connaissances existantes afin de spécifier un système, qui doit répondre à des critères bien définis et dont la valeur a déjà été clairement conceptualisée voire évaluée.
R&D-Innovation et développement de nouvelles activités dans le secteur des énergies bas carbone – Expert de l’industrie de l’hydrogène